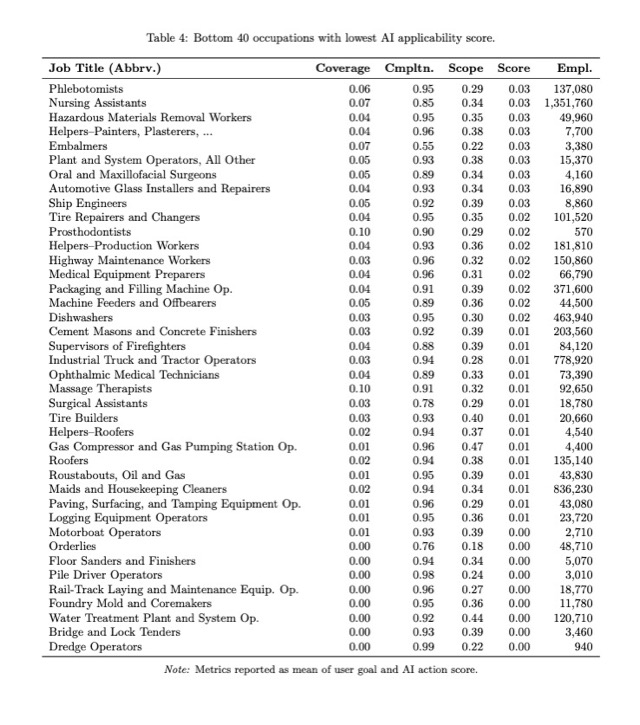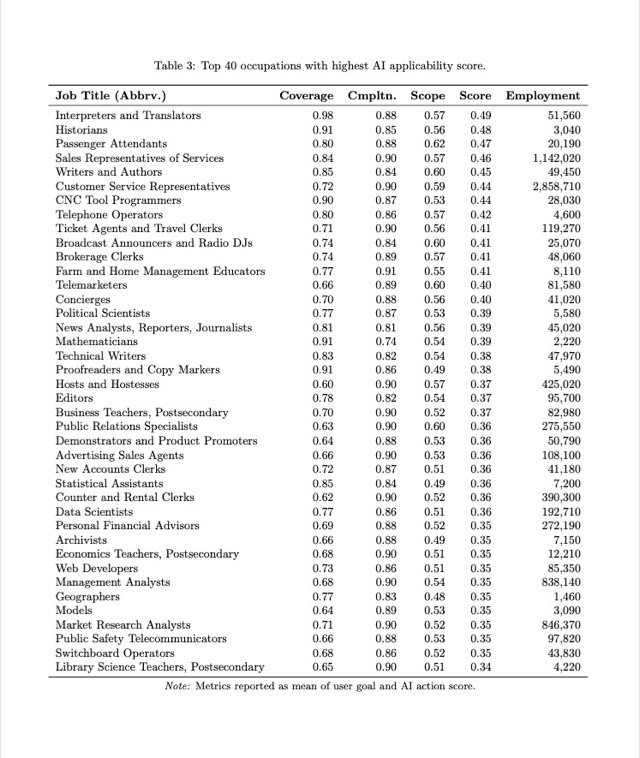Le paysage du crédit à la consommation va profondément évoluer en France à partir du 20 novembre 2026. Mini-prêts, paiements fractionnés ou différés, crédits express… tous ces produits financiers seront désormais encadrés plus strictement. L’objectif affiché par le gouvernement : lutter contre le surendettement, alors que ces crédits sont de plus en plus associés à des situations financières à risque.
Une réglementation plus stricte dès 2026
C’est à travers une ordonnance publiée au Journal officiel, en application d’une directive européenne de 2023, que la France prévoit de renforcer la protection des consommateurs. Le texte entend harmoniser les règles dans l’ensemble du marché européen, tout en renforçant les exigences de transparence sur les contrats de crédit et les conditions de remboursement.
Cette évolution s’inscrit dans un contexte préoccupant. En 2024, 17 % des dossiers de surendettement étudiés par l’Observatoire de l’inclusion bancaire incluaient un mini-crédit ou un paiement fractionné. Des formules souvent attractives à première vue, mais qui peuvent rapidement dégrader la situation financière des emprunteurs les plus fragiles.
De nouveaux produits encadrés
Jusqu’ici, de nombreux crédits à la consommation échappaient à un cadre strict, notamment les mini-crédits de quelques centaines d’euros, les paiements en plusieurs fois sans frais, les crédits inférieurs à 200 euros, les locations avec option d’achat, et les crédits à la consommation allant jusqu’à 100 000 euros.
Dès novembre 2026, tous ces produits seront soumis à la réglementation européenne sur les crédits, ce qui implique de nouvelles obligations pour les organismes prêteurs : plus d’informations à fournir, un examen de la solvabilité plus rigoureux, et une meilleure traçabilité des conditions de prêt.
Publicité et vérification de solvabilité : des règles renforcées
L’ordonnance prévoit également de mieux encadrer les campagnes publicitaires. Il sera désormais interdit de mettre en avant la facilité d’obtention d’un crédit comme argument commercial.
Autre nouveauté, les prêteurs auront la possibilité de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, y compris pour certains crédits courts ou de faible montant. Cette consultation facultative pourra s’appliquer aux crédits remboursables en moins de trois mois, aux montants considérés comme négligeables, ou encore aux offres sans frais.
Une réponse à l’explosion du paiement fractionné
Si le crédit à la consommation n’est pas un phénomène nouveau, ses formes récentes se sont multipliées avec l’essor du e-commerce et des start-up de la fintech. Des acteurs comme Alma, Younited, Cofidis ou Cetelem ont contribué à démocratiser des solutions de paiement ultra-flexibles, souvent perçues comme inoffensives, mais qui peuvent masquer une fragilité financière structurelle.
En adaptant le cadre réglementaire aux usages actuels, le gouvernement cherche à rétablir un équilibre entre innovation financière et sécurité des consommateurs. Un chantier d’autant plus urgent que le nombre de dossiers de surendettement est reparti à la hausse, sur fond de crise du pouvoir d’achat et d’inflation.
Une réforme saluée, mais surveillée
Les associations de consommateurs saluent une réforme longtemps attendue, tout en appelant à la vigilance sur sa mise en œuvre concrète. Le secteur bancaire, lui, salue une clarification bienvenue, notamment pour les acteurs historiques confrontés à la concurrence croissante des fintechs.
Reste à savoir si ce renforcement de la régulation suffira à endiguer la spirale du surendettement, sans freiner l’accès au crédit pour les foyers modestes. La question de l’éducation financière et de l’accompagnement des emprunteurs reste, elle aussi, plus que jamais d’actualité.